
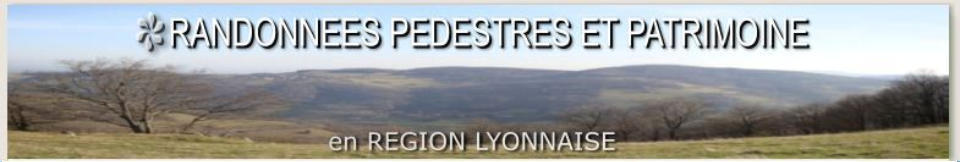
HISTOIRE
A propos de la Croix de Saint ROCH à Bibost
Les renseignements que nous avons sur cette croix proviennent du Pré inventaire des monuments et richesses artistiques intitulé Les croix du canton de l’Arbresle, édité par le département du Rhône en 1994.
l’Arbresle, édité par le département du Rhône en 1994.  Nous avons essayé de trouver d’autres sources : aucun document sur cette croix à la mairie de Bibost ou dans le fonds de bibliothèque de l’association
Nous avons essayé de trouver d’autres sources : aucun document sur cette croix à la mairie de Bibost ou dans le fonds de bibliothèque de l’association Patrimoine d’hier et de demain à Savigny, que nous avons pu consulter. Il paraît indéniable qu’elle ait un lien avec l’abbaye de Savigny encore florissante au
Patrimoine d’hier et de demain à Savigny, que nous avons pu consulter. Il paraît indéniable qu’elle ait un lien avec l’abbaye de Savigny encore florissante au XIVème siècle. Aucun renseignement sur le sculpteur, ni sur le commanditaire, ni sur son emplacement initial (Bibost autrefois régi par l’abbaye de Savigny,
XIVème siècle. Aucun renseignement sur le sculpteur, ni sur le commanditaire, ni sur son emplacement initial (Bibost autrefois régi par l’abbaye de Savigny, hameau de Saint julien sur Bibost, n’est devenu commune indépendante qu’en 1791).
Il est regrettable que son environnement actuel ne la mette pas en valeur. Le cimetière ayant été crée en 1808, on peut penser qu’elle a été déplacée et
hameau de Saint julien sur Bibost, n’est devenu commune indépendante qu’en 1791).
Il est regrettable que son environnement actuel ne la mette pas en valeur. Le cimetière ayant été crée en 1808, on peut penser qu’elle a été déplacée et accolée à son mur Est à cette époque là. Elle demande une observation attentive et répétée pour découvrir tous les détails de sculpture et toute sa richesse
accolée à son mur Est à cette époque là. Elle demande une observation attentive et répétée pour découvrir tous les détails de sculpture et toute sa richesse artistique qui lui valent bien le titre d’œuvre d’art.
artistique qui lui valent bien le titre d’œuvre d’art. Nous nous sommes interrogés sur certains symboles ou représentations.
Nous nous sommes interrogés sur certains symboles ou représentations. Fleur de lys ou iris sur les fleurons du croisillon?
Quel Saint-Jacques : le Mineur ? Ou le Majeur ? Notre hésitation est venue du fait que Jacques le Mineur est associé à l’apôtre Philippe, dont la fête tombe le
Fleur de lys ou iris sur les fleurons du croisillon?
Quel Saint-Jacques : le Mineur ? Ou le Majeur ? Notre hésitation est venue du fait que Jacques le Mineur est associé à l’apôtre Philippe, dont la fête tombe le même jour que la sienne. Son attribut est le bâton de foulon, instrument de son martyre. Mais Jacques le Mineur ne faisait pas partie des 12 apôtres. Si les 4
même jour que la sienne. Son attribut est le bâton de foulon, instrument de son martyre. Mais Jacques le Mineur ne faisait pas partie des 12 apôtres. Si les 4 saints représentés sur le dé sont des apôtres (d’après les commentaires sur cette croix dans le pré-inventaire sur les croix du canton de l’Arbresle), Il s’agirait
saints représentés sur le dé sont des apôtres (d’après les commentaires sur cette croix dans le pré-inventaire sur les croix du canton de l’Arbresle), Il s’agirait plutôt de Saint Jacques le Majeur (représenté avec son bourdon) dont le culte est à l’origine du pèlerinage à St Jacques de Compostelle, et qui était présent lors
plutôt de Saint Jacques le Majeur (représenté avec son bourdon) dont le culte est à l’origine du pèlerinage à St Jacques de Compostelle, et qui était présent lors de l’agonie du Christ au jardin de Gethsémani (Mt 26,37), d’où sa présence au-dessous de Jésus crucifié.
Evêque ou abbé au-dessus du Christ ? La crosse est l’attribut de l’évêque dans la hiérarchie catholique. En héraldique : la crosse des abbés tournée vers
de l’agonie du Christ au jardin de Gethsémani (Mt 26,37), d’où sa présence au-dessous de Jésus crucifié.
Evêque ou abbé au-dessus du Christ ? La crosse est l’attribut de l’évêque dans la hiérarchie catholique. En héraldique : la crosse des abbés tournée vers l’intérieur signifiait que ces derniers exerçaient leur autorité uniquement sur leur abbaye. La crosse des évêques tournée vers l’extérieur, signifiait qu’ils avaient
l’intérieur signifiait que ces derniers exerçaient leur autorité uniquement sur leur abbaye. La crosse des évêques tournée vers l’extérieur, signifiait qu’ils avaient autorité sur tout l’ensemble d’un évêché. Dans le cas de la croix St Roch, la crosse est tournée vers l’extérieur mais compte tenu des rivalités qui existaient entre
autorité sur tout l’ensemble d’un évêché. Dans le cas de la croix St Roch, la crosse est tournée vers l’extérieur mais compte tenu des rivalités qui existaient entre l’abbaye et l’archevêché de Lyon, on peut imaginer qu’il s’agit de l’un des abbés ayant dirigé l’abbaye Saint Martin de Savigny.
l’abbaye et l’archevêché de Lyon, on peut imaginer qu’il s’agit de l’un des abbés ayant dirigé l’abbaye Saint Martin de Savigny. Voir paragraphe : Administration des abbayes au Moyen-Age dans contexte historique ci-dessous
Voir paragraphe : Administration des abbayes au Moyen-Age dans contexte historique ci-dessous Boule ou pomme dans la main de l’Enfant Jésus ? D’après le lexique des symboles chrétiens : lorsque l’Enfant Jésus est représenté en train de tenir une
Boule ou pomme dans la main de l’Enfant Jésus ? D’après le lexique des symboles chrétiens : lorsque l’Enfant Jésus est représenté en train de tenir une pomme, il est fait allusion à sa mission de futur Rédempteur.
Quels prophètes représentés dans les courbures latérales du croisillon ? Parmi les prophètes bibliques les plus connus : Daniel, Elie, Ezéchiel, Isaïe, Jérémie.
pomme, il est fait allusion à sa mission de futur Rédempteur.
Quels prophètes représentés dans les courbures latérales du croisillon ? Parmi les prophètes bibliques les plus connus : Daniel, Elie, Ezéchiel, Isaïe, Jérémie. Placés tous deux de chaque côté du croisillon, entre la Vierge et le Christ, entre l’enfant jésus et le Christ sur la croix, ils font le lien entre les prédictions de
Placés tous deux de chaque côté du croisillon, entre la Vierge et le Christ, entre l’enfant jésus et le Christ sur la croix, ils font le lien entre les prédictions de l’Ancien Testament (livres des prophètes) et le nouveau Testament (vie de Jésus). Les traces de peinture apparentes dans les parties supérieures des courbures
nous rappellent que jusqu’à la fin du XIIIème siècle en France, les statues, une fois sculptées, étaient peintes de couleurs vives.
Enseignement religieux et témoignage d’art
Cette croix a été très probablement commanditée par des ecclésiastiques aisés et instruits, issus de Savigny, soucieux d’enseigner les rudiments de la religion
l’Ancien Testament (livres des prophètes) et le nouveau Testament (vie de Jésus). Les traces de peinture apparentes dans les parties supérieures des courbures
nous rappellent que jusqu’à la fin du XIIIème siècle en France, les statues, une fois sculptées, étaient peintes de couleurs vives.
Enseignement religieux et témoignage d’art
Cette croix a été très probablement commanditée par des ecclésiastiques aisés et instruits, issus de Savigny, soucieux d’enseigner les rudiments de la religion catholique et d’émouvoir les fidèles. Ils ont fait appel à un véritable artiste (inconnu) qui a utilisé les pierres des carrières de la région : pierres de Glay, pierres
catholique et d’émouvoir les fidèles. Ils ont fait appel à un véritable artiste (inconnu) qui a utilisé les pierres des carrières de la région : pierres de Glay, pierres de Lucenay.
Datée de la première moitié du XIVème siècle, en dépit des restes de peinture sur les prophètes, rappelant les siècles qui précèdent, la profusion, et la richesse
de Lucenay.
Datée de la première moitié du XIVème siècle, en dépit des restes de peinture sur les prophètes, rappelant les siècles qui précèdent, la profusion, et la richesse des détails sculptés témoignent du mouvement d’art gothique de cette fin de Moyen-âge.
des détails sculptés témoignent du mouvement d’art gothique de cette fin de Moyen-âge. Recherches historiques suscitées par l’observation de cette croix datée de la première moitié du XIVème s.
La sculpture gothique, intimement liée à l’architecture gothique, s’exprime au travers de sculptures religieuses qui ornent les entrées et les portails des églises.
Recherches historiques suscitées par l’observation de cette croix datée de la première moitié du XIVème s.
La sculpture gothique, intimement liée à l’architecture gothique, s’exprime au travers de sculptures religieuses qui ornent les entrées et les portails des églises. Etaient principalement représentés les thèmes religieux issus de la Bible ou de la vie des saints popularisée par La légende dorée (1262) de Jacques de
Etaient principalement représentés les thèmes religieux issus de la Bible ou de la vie des saints popularisée par La légende dorée (1262) de Jacques de Voragine.
Au Moyen-Age la sculpture est essentiellement décorative. Les traditions de l’art gréco-romain se sont conservées en Provence et en Languedoc et se sont
Voragine.
Au Moyen-Age la sculpture est essentiellement décorative. Les traditions de l’art gréco-romain se sont conservées en Provence et en Languedoc et se sont enrichies d’autres influences : barbares, pour les ornements monstrueux et fantastiques, ou orientales, pour les emprunts aux étoffes de Byzance, de la Perse, et
enrichies d’autres influences : barbares, pour les ornements monstrueux et fantastiques, ou orientales, pour les emprunts aux étoffes de Byzance, de la Perse, et les décorations de chapiteaux.
Quelque soit la source d’inspiration, le sculpteur fait passer dans son œuvre le sentiment de terreur et d’effroi qui agite son âme devant les mystères de l’au-
les décorations de chapiteaux.
Quelque soit la source d’inspiration, le sculpteur fait passer dans son œuvre le sentiment de terreur et d’effroi qui agite son âme devant les mystères de l’au- delà.
Les Ecoles de sculpture au Moyen-Age :
-
au XIIème siècle, avec l’Ecole du Languedoc, la statuaire s’humanise. L’Ecole clunisienne, comme l’Ecole du Languedoc s’inspire de l’art byzantin
delà.
Les Ecoles de sculpture au Moyen-Age :
-
au XIIème siècle, avec l’Ecole du Languedoc, la statuaire s’humanise. L’Ecole clunisienne, comme l’Ecole du Languedoc s’inspire de l’art byzantin mais se soustrait à l’hiératisme (qui concerne les choses sacrées) des arts grecques, et recourt à l’observation, à l’étude directe de la nature.
-
Au XIIIème siècle, l’école de sculpture la plus florissante est l’Ecole de l’Ile de France. Les œuvres des maîtres imagiers, déjà réalistes dans
mais se soustrait à l’hiératisme (qui concerne les choses sacrées) des arts grecques, et recourt à l’observation, à l’étude directe de la nature.
-
Au XIIIème siècle, l’école de sculpture la plus florissante est l’Ecole de l’Ile de France. Les œuvres des maîtres imagiers, déjà réalistes dans l’expression des têtes, présentent une rare justesse dans les mouvements des corps et révèlent un sens dramatique très fort, reliant l’ornementation à
l’expression des têtes, présentent une rare justesse dans les mouvements des corps et révèlent un sens dramatique très fort, reliant l’ornementation à l’architecture. Les motifs sont puisés dans une flore plantureuse, inspirée de la réalité, ou dans une faune d’animaux réels ou fantastiques. La statuaire
l’architecture. Les motifs sont puisés dans une flore plantureuse, inspirée de la réalité, ou dans une faune d’animaux réels ou fantastiques. La statuaire du XIIIème siècle diffère de celle des églises monastiques des siècles précédents. Elle ne se borne pas aux légendes des saints, elle traduit L’Ancien et
le Nouveau Testament et prend en quelque sorte un aspect encyclopédique, en rapport avec la littérature de l’époque (cf. le Spéculum Majus de Vincent
du XIIIème siècle diffère de celle des églises monastiques des siècles précédents. Elle ne se borne pas aux légendes des saints, elle traduit L’Ancien et
le Nouveau Testament et prend en quelque sorte un aspect encyclopédique, en rapport avec la littérature de l’époque (cf. le Spéculum Majus de Vincent de Beauvais).
-
Au XIVème siècle, la sculpture produit une foule importante d’œuvres dans la décoration des églises, palais et tombeaux. Beaucoup de figures
de Beauvais).
-
Au XIVème siècle, la sculpture produit une foule importante d’œuvres dans la décoration des églises, palais et tombeaux. Beaucoup de figures sculptées en ronde bosse ou bas relief, au réalisme très accentué. Par les statues, les vitraux et plus tard par les peintures, l’Eglise et le clergé du
sculptées en ronde bosse ou bas relief, au réalisme très accentué. Par les statues, les vitraux et plus tard par les peintures, l’Eglise et le clergé du Moyen-Age veulent enseigner aux fidèles le plus grand nombre de vérités possibles. Il comprend que pour attacher les foules à ses doctrines, il faut en
Moyen-Age veulent enseigner aux fidèles le plus grand nombre de vérités possibles. Il comprend que pour attacher les foules à ses doctrines, il faut en matérialiser l’expression. L’ordonnance des grandes pages théologiques, morales et scientifiques de l’époque a été réglée par le clergé.
« L’art seul appartient au peintre, l’ordonnance et la disposition appartiennent aux Pères » avait décidé en 787 le Concile de Nicée. Les évêques,
matérialiser l’expression. L’ordonnance des grandes pages théologiques, morales et scientifiques de l’époque a été réglée par le clergé.
« L’art seul appartient au peintre, l’ordonnance et la disposition appartiennent aux Pères » avait décidé en 787 le Concile de Nicée. Les évêques, héritiers des Pères, ont surveillé la décoration de leurs cathédrales, ils ont tracé eux-mêmes le programme et remis aux artistes de véritables livrets qui
héritiers des Pères, ont surveillé la décoration de leurs cathédrales, ils ont tracé eux-mêmes le programme et remis aux artistes de véritables livrets qui devaient être leur guide. Cela remet en question la supposée indépendance d’esprit dont les artistes du Moyen-Age ont été dotés par V. Hugo ou Viollet
devaient être leur guide. Cela remet en question la supposée indépendance d’esprit dont les artistes du Moyen-Age ont été dotés par V. Hugo ou Viollet le Duc. Ces pieux imagiers furent de simples et modestes traducteurs des thèmes parfaitement orthodoxes qui leur étaient fournis. Ce qui est vrai pour
le Duc. Ces pieux imagiers furent de simples et modestes traducteurs des thèmes parfaitement orthodoxes qui leur étaient fournis. Ce qui est vrai pour la sculpture l’est aussi pour l’ornementation des manuscrits et des livres d’heures.
-Au XIVème siècle, l’art est européen, on note une rivalité entre l’art flamand et l’art français pour savoir lequel serait à l’origine de l’autre. Ce qui
la sculpture l’est aussi pour l’ornementation des manuscrits et des livres d’heures.
-Au XIVème siècle, l’art est européen, on note une rivalité entre l’art flamand et l’art français pour savoir lequel serait à l’origine de l’autre. Ce qui importe c’est que tout deux ont abandonné la convention pour la réalité, en sculptant des paysages, des corps, des visages. L’art flamand et l’art
importe c’est que tout deux ont abandonné la convention pour la réalité, en sculptant des paysages, des corps, des visages. L’art flamand et l’art français ont interprété la nature selon leur tempérament respectif.
-Au XVème siècle Ecole de Bourgogne et Ecole de la Loire avant les influences italiennes de la Renaissance.
français ont interprété la nature selon leur tempérament respectif.
-Au XVème siècle Ecole de Bourgogne et Ecole de la Loire avant les influences italiennes de la Renaissance. (Dans Histoire de France illustrée-Tome premier –Des origines à 1610 – Librairie Larousse Paris)
Contexte historique première moitié du XIVème siècle:
Les évènements importants dans le royaume de France :
La guerre de Cent ans : longue suite de batailles, de sièges et de chevauchées, interrompue plusieurs fois par des traités ou des trêves, qui commence en 1337
et se termine en 1453. (Procès de jeanne d’Arc en 1430 et 1431)
(Dans Histoire de France illustrée-Tome premier –Des origines à 1610 – Librairie Larousse Paris)
Contexte historique première moitié du XIVème siècle:
Les évènements importants dans le royaume de France :
La guerre de Cent ans : longue suite de batailles, de sièges et de chevauchées, interrompue plusieurs fois par des traités ou des trêves, qui commence en 1337
et se termine en 1453. (Procès de jeanne d’Arc en 1430 et 1431) Le grand schisme d’occident 1377-1449 avec la chrétienté divisée en deux obédiences : celle du pape romain et celle du pape d’Avignon.
Le grand schisme d’occident 1377-1449 avec la chrétienté divisée en deux obédiences : celle du pape romain et celle du pape d’Avignon. Le Saint-Siège à Avignon : la papauté était devenue en occident au XIIIème siècle, une puissance religieuse, morale et politique. Nicolas II l’avait affranchie de
Le Saint-Siège à Avignon : la papauté était devenue en occident au XIIIème siècle, une puissance religieuse, morale et politique. Nicolas II l’avait affranchie de la protection impériale. Le pape Grégoire VII avait proclamé la supériorité du pouvoir spirituel, réformé les mœurs du clergé en rétablissant dans sa rigueur
la protection impériale. Le pape Grégoire VII avait proclamé la supériorité du pouvoir spirituel, réformé les mœurs du clergé en rétablissant dans sa rigueur primitive le célibat ecclésiastique, et formé le rêve d’une Europe catholique, fédérée sous la croix de Saint Pierre. Sous le pape Boniface VIII, l’affaire des
primitive le célibat ecclésiastique, et formé le rêve d’une Europe catholique, fédérée sous la croix de Saint Pierre. Sous le pape Boniface VIII, l’affaire des Templiers met aux prises le pape et le roi de France, et quelques années plus tard, le pape Clément V, inquiet de l’état troublé de l’Italie, menacé dans Rome
Templiers met aux prises le pape et le roi de France, et quelques années plus tard, le pape Clément V, inquiet de l’état troublé de l’Italie, menacé dans Rome par ses sujets, se réfugie à Avignon en 1309 sous la protection et la tutelle des rois de France. Six papes, tous français imitant l’exemple de Clément V vont
par ses sujets, se réfugie à Avignon en 1309 sous la protection et la tutelle des rois de France. Six papes, tous français imitant l’exemple de Clément V vont prolonger la « captivité de Babylone ». Lorsque que Grégoire XI eut rendu à Rome son ancien rang, un schisme éclata dans l’Eglise. Période critique pour le
prolonger la « captivité de Babylone ». Lorsque que Grégoire XI eut rendu à Rome son ancien rang, un schisme éclata dans l’Eglise. Période critique pour le catholicisme et l’autorité pontificale. Les rois et les princes s’efforcent de secouer de plus en plus la domination temporelle du Saint-Siège, dont la suprématie
catholicisme et l’autorité pontificale. Les rois et les princes s’efforcent de secouer de plus en plus la domination temporelle du Saint-Siège, dont la suprématie spirituelle est contestée non seulement par les hérésies de Wyclef et jean Huss, mais entamée par les conciles eux-mêmes.
Les papes en Avignon :
Clément V
1305- 1314
Urbain V
spirituelle est contestée non seulement par les hérésies de Wyclef et jean Huss, mais entamée par les conciles eux-mêmes.
Les papes en Avignon :
Clément V
1305- 1314
Urbain V 1362-1370
Jean XXII
1362-1370
Jean XXII  1316 – 1334
Grégoire XI
1316 – 1334
Grégoire XI 1370-1378
Benoit XII
1370-1378
Benoit XII 1334- 1342
Clément VI
1334- 1342
Clément VI 1378- 1394
Clément VI
1378- 1394
Clément VI  1342-1352
Benoit XIII
1342-1352
Benoit XIII 1394-1415
Innocent VI
1394-1415
Innocent VI 1352-1362
Le procès des Templiers : sous le règne de Philippe IV le Bel et le pontificat de Clément V. En 1307 arrestation de tous les templiers. Suite au concile de Vienne
1352-1362
Le procès des Templiers : sous le règne de Philippe IV le Bel et le pontificat de Clément V. En 1307 arrestation de tous les templiers. Suite au concile de Vienne de 1311, une bulle pontificale du 3 avril 1312 supprime l’Ordre du Temple. Après sept années d’instruction partiales, Philippe IV Le Bel envoie au bûcher, Le
de 1311, une bulle pontificale du 3 avril 1312 supprime l’Ordre du Temple. Après sept années d’instruction partiales, Philippe IV Le Bel envoie au bûcher, Le Grand Maître Jacques de Molay et le « précepteur » de Normandie Geoffroy de Charnay le 18 mars 1314.
Grand Maître Jacques de Molay et le « précepteur » de Normandie Geoffroy de Charnay le 18 mars 1314. Dans notre région :
La deuxième moitié du XIVème et la première du XVème sont celles de la famine, de la peste et des guerres. La peste bubonique, se développe dans la vallée
Dans notre région :
La deuxième moitié du XIVème et la première du XVème sont celles de la famine, de la peste et des guerres. La peste bubonique, se développe dans la vallée du Rhône à partir de 1347 et emporte en 3 ans environ le tiers de la population. Les différents conflits qui éclatent quelques années plus tard ne permettent pas
du Rhône à partir de 1347 et emporte en 3 ans environ le tiers de la population. Les différents conflits qui éclatent quelques années plus tard ne permettent pas une reprise de la démographie.
De 1357 à 1365 le pays subit plusieurs incursions de bandes armées, comme celles des « Tards Venus » qui sortent parfois vainqueurs face aux grands
une reprise de la démographie.
De 1357 à 1365 le pays subit plusieurs incursions de bandes armées, comme celles des « Tards Venus » qui sortent parfois vainqueurs face aux grands seigneurs. A partir de 1417, et pendant pus de vingt ans, Lyon fidèle au Dauphin futur Charles VII, tente de résister aux ducs de Bourgogne, alliés des anglais
seigneurs. A partir de 1417, et pendant pus de vingt ans, Lyon fidèle au Dauphin futur Charles VII, tente de résister aux ducs de Bourgogne, alliés des anglais tout en essayant de se protéger des pillages des « Ecorcheurs ».
La région s’enfonce dans la misère et de nombreuses abbayes comme celle de Savigny sont pillées. Le Lyonnais met du temps à se relever et il faut attendre le
tout en essayant de se protéger des pillages des « Ecorcheurs ».
La région s’enfonce dans la misère et de nombreuses abbayes comme celle de Savigny sont pillées. Le Lyonnais met du temps à se relever et il faut attendre le milieu du XVème pour une nouvelle phase d’expansion démographique et économique. Les églises sont pour la plupart rapidement reconstruites et
milieu du XVème pour une nouvelle phase d’expansion démographique et économique. Les églises sont pour la plupart rapidement reconstruites et réorganisées. Les rivalités s’apaisent alors peu à peu à l’échelon national mais aussi régional. On est à l’aube des temps modernes.
Les deux grandes abbayes d’Ile Barbe et d’Ainay sont sécularisées au XVIème siècle, celle de Savigny décline lentement. La région subit les affres des guerres
réorganisées. Les rivalités s’apaisent alors peu à peu à l’échelon national mais aussi régional. On est à l’aube des temps modernes.
Les deux grandes abbayes d’Ile Barbe et d’Ainay sont sécularisées au XVIème siècle, celle de Savigny décline lentement. La région subit les affres des guerres de religion puis les destructions de la Révolution.
Les documents relatifs à l’abbaye de Savigny sont nombreux et, pour la plupart conservés aux archives du Rhône. Cependant ils sont rares, concernant l’IXème
de religion puis les destructions de la Révolution.
Les documents relatifs à l’abbaye de Savigny sont nombreux et, pour la plupart conservés aux archives du Rhône. Cependant ils sont rares, concernant l’IXème et la première moitié du Xème siècle, une cinquantaine en tout. La plupart des pièces qui concernent les débuts de l’histoire de l’abbaye et de ses dépendances
et la première moitié du Xème siècle, une cinquantaine en tout. La plupart des pièces qui concernent les débuts de l’histoire de l’abbaye et de ses dépendances sont contenues dans un gros cartulaire, rédigé dans la première moitié du XIIème siècle, sur ordre de l’abbé Ponce (1111-1140). Une vingtaine de pièces y ont
sont contenues dans un gros cartulaire, rédigé dans la première moitié du XIIème siècle, sur ordre de l’abbé Ponce (1111-1140). Une vingtaine de pièces y ont été jointes plus tard. Le manuscrit original semble être perdu mais quatre copies intégrales existent encore aujourd’hui. Une étude en fut notamment faite au
été jointes plus tard. Le manuscrit original semble être perdu mais quatre copies intégrales existent encore aujourd’hui. Une étude en fut notamment faite au XIXème siècle par Auguste Bernard. Toutefois l’authenticité de certains textes a été mise en doute et les dates qui y sont mentionnées semblent très
XIXème siècle par Auguste Bernard. Toutefois l’authenticité de certains textes a été mise en doute et les dates qui y sont mentionnées semblent très approximatives et seraient à rajeunir. On trouve également aux archives l’important et original : « Récit de la fondation et de l’histoire de Savigny » écrit entre
approximatives et seraient à rajeunir. On trouve également aux archives l’important et original : « Récit de la fondation et de l’histoire de Savigny » écrit entre 1490 et 1506, par Benoît Maillard, prieur de l’abbaye.
1490 et 1506, par Benoît Maillard, prieur de l’abbaye. (Dans : Saint Martin de Savigny –mémoire d’une abbaye disparue- p. 14et 15 Publication réalisée par le musée historique de la ville de Lyon Hôtel Gadagne).
Administration des abbayes au Moyen-Age : pour qu’une abbaye puisse être constituée, la présence de douze moines était exigée. L’abbé, élu par les moines
(Dans : Saint Martin de Savigny –mémoire d’une abbaye disparue- p. 14et 15 Publication réalisée par le musée historique de la ville de Lyon Hôtel Gadagne).
Administration des abbayes au Moyen-Age : pour qu’une abbaye puisse être constituée, la présence de douze moines était exigée. L’abbé, élu par les moines de son abbaye, devait se faire confirmer dans les trois mois par son propre évêque, ou, s’il était exempt, par son supérieur général ou par le pape. Investi des
de son abbaye, devait se faire confirmer dans les trois mois par son propre évêque, ou, s’il était exempt, par son supérieur général ou par le pape. Investi des pouvoirs les plus étendus, il se faisait aider dans ses fonctions par des auxiliaires à sa nomination : le prieur (chargé de la discipline intérieure), le prévôt, le
pouvoirs les plus étendus, il se faisait aider dans ses fonctions par des auxiliaires à sa nomination : le prieur (chargé de la discipline intérieure), le prévôt, le doyen, le sacristain, l’aumônier, l’infirmier, le cellerier, l’hospitalier, le portier.
Primitivement l’évêque, exerçait un droit de juridiction et de coercition sur les abbayes situées dans son diocèse. Il présidait à l’élection de l’abbé et pouvait,
doyen, le sacristain, l’aumônier, l’infirmier, le cellerier, l’hospitalier, le portier.
Primitivement l’évêque, exerçait un droit de juridiction et de coercition sur les abbayes situées dans son diocèse. Il présidait à l’élection de l’abbé et pouvait, dans certains cas l’obliger à quitter son monastère. L’expansion du domaine des monastères favorisa leur affranchissement. De là, les abbayes exemptes.
dans certains cas l’obliger à quitter son monastère. L’expansion du domaine des monastères favorisa leur affranchissement. De là, les abbayes exemptes. L’exemption passive conférait simplement aux abbés la juridiction sur leurs religieux alors que l’exemption active leur attribuait juridiction sur toute la population
L’exemption passive conférait simplement aux abbés la juridiction sur leurs religieux alors que l’exemption active leur attribuait juridiction sur toute la population laïque ou monacale dépendant de l’abbaye.
Le bâton pastoral dont l’usage remonte presque aux origines de l’ordre monastique, ne devint qu’ultérieurement un insigne distinctif des évêques ; les abbés se
laïque ou monacale dépendant de l’abbaye.
Le bâton pastoral dont l’usage remonte presque aux origines de l’ordre monastique, ne devint qu’ultérieurement un insigne distinctif des évêques ; les abbés se virent obliger d’y renoncer, à moins d’obtenir un privilège du Saint-Siège. L’anneau ne fut guère concédé aux abbés avant le XIIIème siècle. Le port de la mitre
virent obliger d’y renoncer, à moins d’obtenir un privilège du Saint-Siège. L’anneau ne fut guère concédé aux abbés avant le XIIIème siècle. Le port de la mitre  se répandit surtout au XIème siècle, mais Clément IV régla en 1266 que les abbés exempts ne pourraient porter que la mitre auriphrygiée, sans perles, ni
se répandit surtout au XIème siècle, mais Clément IV régla en 1266 que les abbés exempts ne pourraient porter que la mitre auriphrygiée, sans perles, ni pierres, la mitre précieuse étant réservée aux évêques, et les abbés non exempts se contentaient de la mitre blanche.
pierres, la mitre précieuse étant réservée aux évêques, et les abbés non exempts se contentaient de la mitre blanche. (Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris)
Culte des saints et pèlerinages : le culte de la Vierge, sous le vocable de laquelle on plaçait les cathédrales était très populaire au Moyen-Age et on honorait,
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris)
Culte des saints et pèlerinages : le culte de la Vierge, sous le vocable de laquelle on plaçait les cathédrales était très populaire au Moyen-Age et on honorait, aussi tout particulièrement les saints personnages dont la vie et la mort sont entourées de circonstances miraculeuses. On les considérait comme des
aussi tout particulièrement les saints personnages dont la vie et la mort sont entourées de circonstances miraculeuses. On les considérait comme des protecteurs, des intercesseurs. Les statues et images des saints étaient répandues avec profusion. Ces sentiments se manifestaient par le culte extérieur rendu
protecteurs, des intercesseurs. Les statues et images des saints étaient répandues avec profusion. Ces sentiments se manifestaient par le culte extérieur rendu aux reliques et par de nombreux pèlerinages.
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris
aux reliques et par de nombreux pèlerinages.
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris
 l’Arbresle, édité par le département du Rhône en 1994.
l’Arbresle, édité par le département du Rhône en 1994.  Nous avons essayé de trouver d’autres sources : aucun document sur cette croix à la mairie de Bibost ou dans le fonds de bibliothèque de l’association
Nous avons essayé de trouver d’autres sources : aucun document sur cette croix à la mairie de Bibost ou dans le fonds de bibliothèque de l’association Patrimoine d’hier et de demain à Savigny, que nous avons pu consulter. Il paraît indéniable qu’elle ait un lien avec l’abbaye de Savigny encore florissante au
Patrimoine d’hier et de demain à Savigny, que nous avons pu consulter. Il paraît indéniable qu’elle ait un lien avec l’abbaye de Savigny encore florissante au XIVème siècle. Aucun renseignement sur le sculpteur, ni sur le commanditaire, ni sur son emplacement initial (Bibost autrefois régi par l’abbaye de Savigny,
XIVème siècle. Aucun renseignement sur le sculpteur, ni sur le commanditaire, ni sur son emplacement initial (Bibost autrefois régi par l’abbaye de Savigny, hameau de Saint julien sur Bibost, n’est devenu commune indépendante qu’en 1791).
Il est regrettable que son environnement actuel ne la mette pas en valeur. Le cimetière ayant été crée en 1808, on peut penser qu’elle a été déplacée et
hameau de Saint julien sur Bibost, n’est devenu commune indépendante qu’en 1791).
Il est regrettable que son environnement actuel ne la mette pas en valeur. Le cimetière ayant été crée en 1808, on peut penser qu’elle a été déplacée et accolée à son mur Est à cette époque là. Elle demande une observation attentive et répétée pour découvrir tous les détails de sculpture et toute sa richesse
accolée à son mur Est à cette époque là. Elle demande une observation attentive et répétée pour découvrir tous les détails de sculpture et toute sa richesse artistique qui lui valent bien le titre d’œuvre d’art.
artistique qui lui valent bien le titre d’œuvre d’art. Nous nous sommes interrogés sur certains symboles ou représentations.
Nous nous sommes interrogés sur certains symboles ou représentations. Fleur de lys ou iris sur les fleurons du croisillon?
Quel Saint-Jacques : le Mineur ? Ou le Majeur ? Notre hésitation est venue du fait que Jacques le Mineur est associé à l’apôtre Philippe, dont la fête tombe le
Fleur de lys ou iris sur les fleurons du croisillon?
Quel Saint-Jacques : le Mineur ? Ou le Majeur ? Notre hésitation est venue du fait que Jacques le Mineur est associé à l’apôtre Philippe, dont la fête tombe le même jour que la sienne. Son attribut est le bâton de foulon, instrument de son martyre. Mais Jacques le Mineur ne faisait pas partie des 12 apôtres. Si les 4
même jour que la sienne. Son attribut est le bâton de foulon, instrument de son martyre. Mais Jacques le Mineur ne faisait pas partie des 12 apôtres. Si les 4 saints représentés sur le dé sont des apôtres (d’après les commentaires sur cette croix dans le pré-inventaire sur les croix du canton de l’Arbresle), Il s’agirait
saints représentés sur le dé sont des apôtres (d’après les commentaires sur cette croix dans le pré-inventaire sur les croix du canton de l’Arbresle), Il s’agirait plutôt de Saint Jacques le Majeur (représenté avec son bourdon) dont le culte est à l’origine du pèlerinage à St Jacques de Compostelle, et qui était présent lors
plutôt de Saint Jacques le Majeur (représenté avec son bourdon) dont le culte est à l’origine du pèlerinage à St Jacques de Compostelle, et qui était présent lors de l’agonie du Christ au jardin de Gethsémani (Mt 26,37), d’où sa présence au-dessous de Jésus crucifié.
Evêque ou abbé au-dessus du Christ ? La crosse est l’attribut de l’évêque dans la hiérarchie catholique. En héraldique : la crosse des abbés tournée vers
de l’agonie du Christ au jardin de Gethsémani (Mt 26,37), d’où sa présence au-dessous de Jésus crucifié.
Evêque ou abbé au-dessus du Christ ? La crosse est l’attribut de l’évêque dans la hiérarchie catholique. En héraldique : la crosse des abbés tournée vers l’intérieur signifiait que ces derniers exerçaient leur autorité uniquement sur leur abbaye. La crosse des évêques tournée vers l’extérieur, signifiait qu’ils avaient
l’intérieur signifiait que ces derniers exerçaient leur autorité uniquement sur leur abbaye. La crosse des évêques tournée vers l’extérieur, signifiait qu’ils avaient autorité sur tout l’ensemble d’un évêché. Dans le cas de la croix St Roch, la crosse est tournée vers l’extérieur mais compte tenu des rivalités qui existaient entre
autorité sur tout l’ensemble d’un évêché. Dans le cas de la croix St Roch, la crosse est tournée vers l’extérieur mais compte tenu des rivalités qui existaient entre l’abbaye et l’archevêché de Lyon, on peut imaginer qu’il s’agit de l’un des abbés ayant dirigé l’abbaye Saint Martin de Savigny.
l’abbaye et l’archevêché de Lyon, on peut imaginer qu’il s’agit de l’un des abbés ayant dirigé l’abbaye Saint Martin de Savigny. Voir paragraphe : Administration des abbayes au Moyen-Age dans contexte historique ci-dessous
Voir paragraphe : Administration des abbayes au Moyen-Age dans contexte historique ci-dessous Boule ou pomme dans la main de l’Enfant Jésus ? D’après le lexique des symboles chrétiens : lorsque l’Enfant Jésus est représenté en train de tenir une
Boule ou pomme dans la main de l’Enfant Jésus ? D’après le lexique des symboles chrétiens : lorsque l’Enfant Jésus est représenté en train de tenir une pomme, il est fait allusion à sa mission de futur Rédempteur.
Quels prophètes représentés dans les courbures latérales du croisillon ? Parmi les prophètes bibliques les plus connus : Daniel, Elie, Ezéchiel, Isaïe, Jérémie.
pomme, il est fait allusion à sa mission de futur Rédempteur.
Quels prophètes représentés dans les courbures latérales du croisillon ? Parmi les prophètes bibliques les plus connus : Daniel, Elie, Ezéchiel, Isaïe, Jérémie. Placés tous deux de chaque côté du croisillon, entre la Vierge et le Christ, entre l’enfant jésus et le Christ sur la croix, ils font le lien entre les prédictions de
Placés tous deux de chaque côté du croisillon, entre la Vierge et le Christ, entre l’enfant jésus et le Christ sur la croix, ils font le lien entre les prédictions de l’Ancien Testament (livres des prophètes) et le nouveau Testament (vie de Jésus). Les traces de peinture apparentes dans les parties supérieures des courbures
nous rappellent que jusqu’à la fin du XIIIème siècle en France, les statues, une fois sculptées, étaient peintes de couleurs vives.
Enseignement religieux et témoignage d’art
Cette croix a été très probablement commanditée par des ecclésiastiques aisés et instruits, issus de Savigny, soucieux d’enseigner les rudiments de la religion
l’Ancien Testament (livres des prophètes) et le nouveau Testament (vie de Jésus). Les traces de peinture apparentes dans les parties supérieures des courbures
nous rappellent que jusqu’à la fin du XIIIème siècle en France, les statues, une fois sculptées, étaient peintes de couleurs vives.
Enseignement religieux et témoignage d’art
Cette croix a été très probablement commanditée par des ecclésiastiques aisés et instruits, issus de Savigny, soucieux d’enseigner les rudiments de la religion catholique et d’émouvoir les fidèles. Ils ont fait appel à un véritable artiste (inconnu) qui a utilisé les pierres des carrières de la région : pierres de Glay, pierres
catholique et d’émouvoir les fidèles. Ils ont fait appel à un véritable artiste (inconnu) qui a utilisé les pierres des carrières de la région : pierres de Glay, pierres de Lucenay.
Datée de la première moitié du XIVème siècle, en dépit des restes de peinture sur les prophètes, rappelant les siècles qui précèdent, la profusion, et la richesse
de Lucenay.
Datée de la première moitié du XIVème siècle, en dépit des restes de peinture sur les prophètes, rappelant les siècles qui précèdent, la profusion, et la richesse des détails sculptés témoignent du mouvement d’art gothique de cette fin de Moyen-âge.
des détails sculptés témoignent du mouvement d’art gothique de cette fin de Moyen-âge. Recherches historiques suscitées par l’observation de cette croix datée de la première moitié du XIVème s.
La sculpture gothique, intimement liée à l’architecture gothique, s’exprime au travers de sculptures religieuses qui ornent les entrées et les portails des églises.
Recherches historiques suscitées par l’observation de cette croix datée de la première moitié du XIVème s.
La sculpture gothique, intimement liée à l’architecture gothique, s’exprime au travers de sculptures religieuses qui ornent les entrées et les portails des églises. Etaient principalement représentés les thèmes religieux issus de la Bible ou de la vie des saints popularisée par La légende dorée (1262) de Jacques de
Etaient principalement représentés les thèmes religieux issus de la Bible ou de la vie des saints popularisée par La légende dorée (1262) de Jacques de Voragine.
Au Moyen-Age la sculpture est essentiellement décorative. Les traditions de l’art gréco-romain se sont conservées en Provence et en Languedoc et se sont
Voragine.
Au Moyen-Age la sculpture est essentiellement décorative. Les traditions de l’art gréco-romain se sont conservées en Provence et en Languedoc et se sont enrichies d’autres influences : barbares, pour les ornements monstrueux et fantastiques, ou orientales, pour les emprunts aux étoffes de Byzance, de la Perse, et
enrichies d’autres influences : barbares, pour les ornements monstrueux et fantastiques, ou orientales, pour les emprunts aux étoffes de Byzance, de la Perse, et les décorations de chapiteaux.
Quelque soit la source d’inspiration, le sculpteur fait passer dans son œuvre le sentiment de terreur et d’effroi qui agite son âme devant les mystères de l’au-
les décorations de chapiteaux.
Quelque soit la source d’inspiration, le sculpteur fait passer dans son œuvre le sentiment de terreur et d’effroi qui agite son âme devant les mystères de l’au- delà.
Les Ecoles de sculpture au Moyen-Age :
-
au XIIème siècle, avec l’Ecole du Languedoc, la statuaire s’humanise. L’Ecole clunisienne, comme l’Ecole du Languedoc s’inspire de l’art byzantin
delà.
Les Ecoles de sculpture au Moyen-Age :
-
au XIIème siècle, avec l’Ecole du Languedoc, la statuaire s’humanise. L’Ecole clunisienne, comme l’Ecole du Languedoc s’inspire de l’art byzantin mais se soustrait à l’hiératisme (qui concerne les choses sacrées) des arts grecques, et recourt à l’observation, à l’étude directe de la nature.
-
Au XIIIème siècle, l’école de sculpture la plus florissante est l’Ecole de l’Ile de France. Les œuvres des maîtres imagiers, déjà réalistes dans
mais se soustrait à l’hiératisme (qui concerne les choses sacrées) des arts grecques, et recourt à l’observation, à l’étude directe de la nature.
-
Au XIIIème siècle, l’école de sculpture la plus florissante est l’Ecole de l’Ile de France. Les œuvres des maîtres imagiers, déjà réalistes dans l’expression des têtes, présentent une rare justesse dans les mouvements des corps et révèlent un sens dramatique très fort, reliant l’ornementation à
l’expression des têtes, présentent une rare justesse dans les mouvements des corps et révèlent un sens dramatique très fort, reliant l’ornementation à l’architecture. Les motifs sont puisés dans une flore plantureuse, inspirée de la réalité, ou dans une faune d’animaux réels ou fantastiques. La statuaire
l’architecture. Les motifs sont puisés dans une flore plantureuse, inspirée de la réalité, ou dans une faune d’animaux réels ou fantastiques. La statuaire du XIIIème siècle diffère de celle des églises monastiques des siècles précédents. Elle ne se borne pas aux légendes des saints, elle traduit L’Ancien et
le Nouveau Testament et prend en quelque sorte un aspect encyclopédique, en rapport avec la littérature de l’époque (cf. le Spéculum Majus de Vincent
du XIIIème siècle diffère de celle des églises monastiques des siècles précédents. Elle ne se borne pas aux légendes des saints, elle traduit L’Ancien et
le Nouveau Testament et prend en quelque sorte un aspect encyclopédique, en rapport avec la littérature de l’époque (cf. le Spéculum Majus de Vincent de Beauvais).
-
Au XIVème siècle, la sculpture produit une foule importante d’œuvres dans la décoration des églises, palais et tombeaux. Beaucoup de figures
de Beauvais).
-
Au XIVème siècle, la sculpture produit une foule importante d’œuvres dans la décoration des églises, palais et tombeaux. Beaucoup de figures sculptées en ronde bosse ou bas relief, au réalisme très accentué. Par les statues, les vitraux et plus tard par les peintures, l’Eglise et le clergé du
sculptées en ronde bosse ou bas relief, au réalisme très accentué. Par les statues, les vitraux et plus tard par les peintures, l’Eglise et le clergé du Moyen-Age veulent enseigner aux fidèles le plus grand nombre de vérités possibles. Il comprend que pour attacher les foules à ses doctrines, il faut en
Moyen-Age veulent enseigner aux fidèles le plus grand nombre de vérités possibles. Il comprend que pour attacher les foules à ses doctrines, il faut en matérialiser l’expression. L’ordonnance des grandes pages théologiques, morales et scientifiques de l’époque a été réglée par le clergé.
« L’art seul appartient au peintre, l’ordonnance et la disposition appartiennent aux Pères » avait décidé en 787 le Concile de Nicée. Les évêques,
matérialiser l’expression. L’ordonnance des grandes pages théologiques, morales et scientifiques de l’époque a été réglée par le clergé.
« L’art seul appartient au peintre, l’ordonnance et la disposition appartiennent aux Pères » avait décidé en 787 le Concile de Nicée. Les évêques, héritiers des Pères, ont surveillé la décoration de leurs cathédrales, ils ont tracé eux-mêmes le programme et remis aux artistes de véritables livrets qui
héritiers des Pères, ont surveillé la décoration de leurs cathédrales, ils ont tracé eux-mêmes le programme et remis aux artistes de véritables livrets qui devaient être leur guide. Cela remet en question la supposée indépendance d’esprit dont les artistes du Moyen-Age ont été dotés par V. Hugo ou Viollet
devaient être leur guide. Cela remet en question la supposée indépendance d’esprit dont les artistes du Moyen-Age ont été dotés par V. Hugo ou Viollet le Duc. Ces pieux imagiers furent de simples et modestes traducteurs des thèmes parfaitement orthodoxes qui leur étaient fournis. Ce qui est vrai pour
le Duc. Ces pieux imagiers furent de simples et modestes traducteurs des thèmes parfaitement orthodoxes qui leur étaient fournis. Ce qui est vrai pour la sculpture l’est aussi pour l’ornementation des manuscrits et des livres d’heures.
-Au XIVème siècle, l’art est européen, on note une rivalité entre l’art flamand et l’art français pour savoir lequel serait à l’origine de l’autre. Ce qui
la sculpture l’est aussi pour l’ornementation des manuscrits et des livres d’heures.
-Au XIVème siècle, l’art est européen, on note une rivalité entre l’art flamand et l’art français pour savoir lequel serait à l’origine de l’autre. Ce qui importe c’est que tout deux ont abandonné la convention pour la réalité, en sculptant des paysages, des corps, des visages. L’art flamand et l’art
importe c’est que tout deux ont abandonné la convention pour la réalité, en sculptant des paysages, des corps, des visages. L’art flamand et l’art français ont interprété la nature selon leur tempérament respectif.
-Au XVème siècle Ecole de Bourgogne et Ecole de la Loire avant les influences italiennes de la Renaissance.
français ont interprété la nature selon leur tempérament respectif.
-Au XVème siècle Ecole de Bourgogne et Ecole de la Loire avant les influences italiennes de la Renaissance. (Dans Histoire de France illustrée-Tome premier –Des origines à 1610 – Librairie Larousse Paris)
Contexte historique première moitié du XIVème siècle:
Les évènements importants dans le royaume de France :
La guerre de Cent ans : longue suite de batailles, de sièges et de chevauchées, interrompue plusieurs fois par des traités ou des trêves, qui commence en 1337
et se termine en 1453. (Procès de jeanne d’Arc en 1430 et 1431)
(Dans Histoire de France illustrée-Tome premier –Des origines à 1610 – Librairie Larousse Paris)
Contexte historique première moitié du XIVème siècle:
Les évènements importants dans le royaume de France :
La guerre de Cent ans : longue suite de batailles, de sièges et de chevauchées, interrompue plusieurs fois par des traités ou des trêves, qui commence en 1337
et se termine en 1453. (Procès de jeanne d’Arc en 1430 et 1431) Le grand schisme d’occident 1377-1449 avec la chrétienté divisée en deux obédiences : celle du pape romain et celle du pape d’Avignon.
Le grand schisme d’occident 1377-1449 avec la chrétienté divisée en deux obédiences : celle du pape romain et celle du pape d’Avignon. Le Saint-Siège à Avignon : la papauté était devenue en occident au XIIIème siècle, une puissance religieuse, morale et politique. Nicolas II l’avait affranchie de
Le Saint-Siège à Avignon : la papauté était devenue en occident au XIIIème siècle, une puissance religieuse, morale et politique. Nicolas II l’avait affranchie de la protection impériale. Le pape Grégoire VII avait proclamé la supériorité du pouvoir spirituel, réformé les mœurs du clergé en rétablissant dans sa rigueur
la protection impériale. Le pape Grégoire VII avait proclamé la supériorité du pouvoir spirituel, réformé les mœurs du clergé en rétablissant dans sa rigueur primitive le célibat ecclésiastique, et formé le rêve d’une Europe catholique, fédérée sous la croix de Saint Pierre. Sous le pape Boniface VIII, l’affaire des
primitive le célibat ecclésiastique, et formé le rêve d’une Europe catholique, fédérée sous la croix de Saint Pierre. Sous le pape Boniface VIII, l’affaire des Templiers met aux prises le pape et le roi de France, et quelques années plus tard, le pape Clément V, inquiet de l’état troublé de l’Italie, menacé dans Rome
Templiers met aux prises le pape et le roi de France, et quelques années plus tard, le pape Clément V, inquiet de l’état troublé de l’Italie, menacé dans Rome par ses sujets, se réfugie à Avignon en 1309 sous la protection et la tutelle des rois de France. Six papes, tous français imitant l’exemple de Clément V vont
par ses sujets, se réfugie à Avignon en 1309 sous la protection et la tutelle des rois de France. Six papes, tous français imitant l’exemple de Clément V vont prolonger la « captivité de Babylone ». Lorsque que Grégoire XI eut rendu à Rome son ancien rang, un schisme éclata dans l’Eglise. Période critique pour le
prolonger la « captivité de Babylone ». Lorsque que Grégoire XI eut rendu à Rome son ancien rang, un schisme éclata dans l’Eglise. Période critique pour le catholicisme et l’autorité pontificale. Les rois et les princes s’efforcent de secouer de plus en plus la domination temporelle du Saint-Siège, dont la suprématie
catholicisme et l’autorité pontificale. Les rois et les princes s’efforcent de secouer de plus en plus la domination temporelle du Saint-Siège, dont la suprématie spirituelle est contestée non seulement par les hérésies de Wyclef et jean Huss, mais entamée par les conciles eux-mêmes.
Les papes en Avignon :
Clément V
1305- 1314
Urbain V
spirituelle est contestée non seulement par les hérésies de Wyclef et jean Huss, mais entamée par les conciles eux-mêmes.
Les papes en Avignon :
Clément V
1305- 1314
Urbain V 1362-1370
Jean XXII
1362-1370
Jean XXII  1316 – 1334
Grégoire XI
1316 – 1334
Grégoire XI 1370-1378
Benoit XII
1370-1378
Benoit XII 1334- 1342
Clément VI
1334- 1342
Clément VI 1378- 1394
Clément VI
1378- 1394
Clément VI  1342-1352
Benoit XIII
1342-1352
Benoit XIII 1394-1415
Innocent VI
1394-1415
Innocent VI 1352-1362
Le procès des Templiers : sous le règne de Philippe IV le Bel et le pontificat de Clément V. En 1307 arrestation de tous les templiers. Suite au concile de Vienne
1352-1362
Le procès des Templiers : sous le règne de Philippe IV le Bel et le pontificat de Clément V. En 1307 arrestation de tous les templiers. Suite au concile de Vienne de 1311, une bulle pontificale du 3 avril 1312 supprime l’Ordre du Temple. Après sept années d’instruction partiales, Philippe IV Le Bel envoie au bûcher, Le
de 1311, une bulle pontificale du 3 avril 1312 supprime l’Ordre du Temple. Après sept années d’instruction partiales, Philippe IV Le Bel envoie au bûcher, Le Grand Maître Jacques de Molay et le « précepteur » de Normandie Geoffroy de Charnay le 18 mars 1314.
Grand Maître Jacques de Molay et le « précepteur » de Normandie Geoffroy de Charnay le 18 mars 1314. Dans notre région :
La deuxième moitié du XIVème et la première du XVème sont celles de la famine, de la peste et des guerres. La peste bubonique, se développe dans la vallée
Dans notre région :
La deuxième moitié du XIVème et la première du XVème sont celles de la famine, de la peste et des guerres. La peste bubonique, se développe dans la vallée du Rhône à partir de 1347 et emporte en 3 ans environ le tiers de la population. Les différents conflits qui éclatent quelques années plus tard ne permettent pas
du Rhône à partir de 1347 et emporte en 3 ans environ le tiers de la population. Les différents conflits qui éclatent quelques années plus tard ne permettent pas une reprise de la démographie.
De 1357 à 1365 le pays subit plusieurs incursions de bandes armées, comme celles des « Tards Venus » qui sortent parfois vainqueurs face aux grands
une reprise de la démographie.
De 1357 à 1365 le pays subit plusieurs incursions de bandes armées, comme celles des « Tards Venus » qui sortent parfois vainqueurs face aux grands seigneurs. A partir de 1417, et pendant pus de vingt ans, Lyon fidèle au Dauphin futur Charles VII, tente de résister aux ducs de Bourgogne, alliés des anglais
seigneurs. A partir de 1417, et pendant pus de vingt ans, Lyon fidèle au Dauphin futur Charles VII, tente de résister aux ducs de Bourgogne, alliés des anglais tout en essayant de se protéger des pillages des « Ecorcheurs ».
La région s’enfonce dans la misère et de nombreuses abbayes comme celle de Savigny sont pillées. Le Lyonnais met du temps à se relever et il faut attendre le
tout en essayant de se protéger des pillages des « Ecorcheurs ».
La région s’enfonce dans la misère et de nombreuses abbayes comme celle de Savigny sont pillées. Le Lyonnais met du temps à se relever et il faut attendre le milieu du XVème pour une nouvelle phase d’expansion démographique et économique. Les églises sont pour la plupart rapidement reconstruites et
milieu du XVème pour une nouvelle phase d’expansion démographique et économique. Les églises sont pour la plupart rapidement reconstruites et réorganisées. Les rivalités s’apaisent alors peu à peu à l’échelon national mais aussi régional. On est à l’aube des temps modernes.
Les deux grandes abbayes d’Ile Barbe et d’Ainay sont sécularisées au XVIème siècle, celle de Savigny décline lentement. La région subit les affres des guerres
réorganisées. Les rivalités s’apaisent alors peu à peu à l’échelon national mais aussi régional. On est à l’aube des temps modernes.
Les deux grandes abbayes d’Ile Barbe et d’Ainay sont sécularisées au XVIème siècle, celle de Savigny décline lentement. La région subit les affres des guerres de religion puis les destructions de la Révolution.
Les documents relatifs à l’abbaye de Savigny sont nombreux et, pour la plupart conservés aux archives du Rhône. Cependant ils sont rares, concernant l’IXème
de religion puis les destructions de la Révolution.
Les documents relatifs à l’abbaye de Savigny sont nombreux et, pour la plupart conservés aux archives du Rhône. Cependant ils sont rares, concernant l’IXème et la première moitié du Xème siècle, une cinquantaine en tout. La plupart des pièces qui concernent les débuts de l’histoire de l’abbaye et de ses dépendances
et la première moitié du Xème siècle, une cinquantaine en tout. La plupart des pièces qui concernent les débuts de l’histoire de l’abbaye et de ses dépendances sont contenues dans un gros cartulaire, rédigé dans la première moitié du XIIème siècle, sur ordre de l’abbé Ponce (1111-1140). Une vingtaine de pièces y ont
sont contenues dans un gros cartulaire, rédigé dans la première moitié du XIIème siècle, sur ordre de l’abbé Ponce (1111-1140). Une vingtaine de pièces y ont été jointes plus tard. Le manuscrit original semble être perdu mais quatre copies intégrales existent encore aujourd’hui. Une étude en fut notamment faite au
été jointes plus tard. Le manuscrit original semble être perdu mais quatre copies intégrales existent encore aujourd’hui. Une étude en fut notamment faite au XIXème siècle par Auguste Bernard. Toutefois l’authenticité de certains textes a été mise en doute et les dates qui y sont mentionnées semblent très
XIXème siècle par Auguste Bernard. Toutefois l’authenticité de certains textes a été mise en doute et les dates qui y sont mentionnées semblent très approximatives et seraient à rajeunir. On trouve également aux archives l’important et original : « Récit de la fondation et de l’histoire de Savigny » écrit entre
approximatives et seraient à rajeunir. On trouve également aux archives l’important et original : « Récit de la fondation et de l’histoire de Savigny » écrit entre 1490 et 1506, par Benoît Maillard, prieur de l’abbaye.
1490 et 1506, par Benoît Maillard, prieur de l’abbaye. (Dans : Saint Martin de Savigny –mémoire d’une abbaye disparue- p. 14et 15 Publication réalisée par le musée historique de la ville de Lyon Hôtel Gadagne).
Administration des abbayes au Moyen-Age : pour qu’une abbaye puisse être constituée, la présence de douze moines était exigée. L’abbé, élu par les moines
(Dans : Saint Martin de Savigny –mémoire d’une abbaye disparue- p. 14et 15 Publication réalisée par le musée historique de la ville de Lyon Hôtel Gadagne).
Administration des abbayes au Moyen-Age : pour qu’une abbaye puisse être constituée, la présence de douze moines était exigée. L’abbé, élu par les moines de son abbaye, devait se faire confirmer dans les trois mois par son propre évêque, ou, s’il était exempt, par son supérieur général ou par le pape. Investi des
de son abbaye, devait se faire confirmer dans les trois mois par son propre évêque, ou, s’il était exempt, par son supérieur général ou par le pape. Investi des pouvoirs les plus étendus, il se faisait aider dans ses fonctions par des auxiliaires à sa nomination : le prieur (chargé de la discipline intérieure), le prévôt, le
pouvoirs les plus étendus, il se faisait aider dans ses fonctions par des auxiliaires à sa nomination : le prieur (chargé de la discipline intérieure), le prévôt, le doyen, le sacristain, l’aumônier, l’infirmier, le cellerier, l’hospitalier, le portier.
Primitivement l’évêque, exerçait un droit de juridiction et de coercition sur les abbayes situées dans son diocèse. Il présidait à l’élection de l’abbé et pouvait,
doyen, le sacristain, l’aumônier, l’infirmier, le cellerier, l’hospitalier, le portier.
Primitivement l’évêque, exerçait un droit de juridiction et de coercition sur les abbayes situées dans son diocèse. Il présidait à l’élection de l’abbé et pouvait, dans certains cas l’obliger à quitter son monastère. L’expansion du domaine des monastères favorisa leur affranchissement. De là, les abbayes exemptes.
dans certains cas l’obliger à quitter son monastère. L’expansion du domaine des monastères favorisa leur affranchissement. De là, les abbayes exemptes. L’exemption passive conférait simplement aux abbés la juridiction sur leurs religieux alors que l’exemption active leur attribuait juridiction sur toute la population
L’exemption passive conférait simplement aux abbés la juridiction sur leurs religieux alors que l’exemption active leur attribuait juridiction sur toute la population laïque ou monacale dépendant de l’abbaye.
Le bâton pastoral dont l’usage remonte presque aux origines de l’ordre monastique, ne devint qu’ultérieurement un insigne distinctif des évêques ; les abbés se
laïque ou monacale dépendant de l’abbaye.
Le bâton pastoral dont l’usage remonte presque aux origines de l’ordre monastique, ne devint qu’ultérieurement un insigne distinctif des évêques ; les abbés se virent obliger d’y renoncer, à moins d’obtenir un privilège du Saint-Siège. L’anneau ne fut guère concédé aux abbés avant le XIIIème siècle. Le port de la mitre
virent obliger d’y renoncer, à moins d’obtenir un privilège du Saint-Siège. L’anneau ne fut guère concédé aux abbés avant le XIIIème siècle. Le port de la mitre  se répandit surtout au XIème siècle, mais Clément IV régla en 1266 que les abbés exempts ne pourraient porter que la mitre auriphrygiée, sans perles, ni
se répandit surtout au XIème siècle, mais Clément IV régla en 1266 que les abbés exempts ne pourraient porter que la mitre auriphrygiée, sans perles, ni pierres, la mitre précieuse étant réservée aux évêques, et les abbés non exempts se contentaient de la mitre blanche.
pierres, la mitre précieuse étant réservée aux évêques, et les abbés non exempts se contentaient de la mitre blanche. (Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris)
Culte des saints et pèlerinages : le culte de la Vierge, sous le vocable de laquelle on plaçait les cathédrales était très populaire au Moyen-Age et on honorait,
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris)
Culte des saints et pèlerinages : le culte de la Vierge, sous le vocable de laquelle on plaçait les cathédrales était très populaire au Moyen-Age et on honorait, aussi tout particulièrement les saints personnages dont la vie et la mort sont entourées de circonstances miraculeuses. On les considérait comme des
aussi tout particulièrement les saints personnages dont la vie et la mort sont entourées de circonstances miraculeuses. On les considérait comme des protecteurs, des intercesseurs. Les statues et images des saints étaient répandues avec profusion. Ces sentiments se manifestaient par le culte extérieur rendu
protecteurs, des intercesseurs. Les statues et images des saints étaient répandues avec profusion. Ces sentiments se manifestaient par le culte extérieur rendu aux reliques et par de nombreux pèlerinages.
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris
aux reliques et par de nombreux pèlerinages.
(Dans Histoire de France illustrée -tome premier- Des origines à 1610 - librairie Larousse Paris