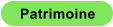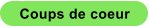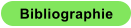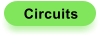
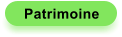
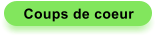

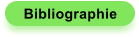


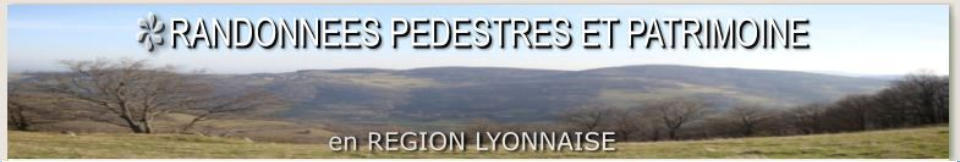
HISTOIRE
Un petit bout de Pilat rhodanien ...
... à 1 heure de voiture au sud de Lyon
Dominant la rive droite du Rhône, sur un petit plateau de 300 à 500 mètres d’altitude, notre terrain de découverte est bordé au Nord par le ruisseau de Collonge et au Sud par les gorges de Malleval, deux petits ruisseaux, affluents de la rive droite du Rhône.
Collonge et au Sud par les gorges de Malleval, deux petits ruisseaux, affluents de la rive droite du Rhône. Le climat protégé de ce flanc Est du Pilat a permis à la population actuelle de se tourner vers l’agriculture fruitière. Les vergers de pommiers, de plus
Le climat protégé de ce flanc Est du Pilat a permis à la population actuelle de se tourner vers l’agriculture fruitière. Les vergers de pommiers, de plus en plus fréquemment couverts de protections plastiques, jouxtent très rapidement les sombres forêts de résineux que fragmentent ici et là les chirats,
en plus fréquemment couverts de protections plastiques, jouxtent très rapidement les sombres forêts de résineux que fragmentent ici et là les chirats, ces éboulements de cailloux caractéristiques de l’érosion du massif qui culmine à 1405 mètres d’altitude.
ces éboulements de cailloux caractéristiques de l’érosion du massif qui culmine à 1405 mètres d’altitude. L’habitat, volontiers dispersé, a pris appui sur des bourgs au riche passé historique : Pélussin, pays des sires de Virieu, mais aussi Maclas, au
L’habitat, volontiers dispersé, a pris appui sur des bourgs au riche passé historique : Pélussin, pays des sires de Virieu, mais aussi Maclas, au dynamisme économique récent, et, plus au bord du Rhône, les bourgades de Chavanay ou Saint-Pierre-de- Bœuf qui encadrent l’ancien bourg féodal
dynamisme économique récent, et, plus au bord du Rhône, les bourgades de Chavanay ou Saint-Pierre-de- Bœuf qui encadrent l’ancien bourg féodal de Malleval.
de Malleval. Historiquement, ce petit territoire a été marqué par son caractère de marche frontière, à divers titres :
Historiquement, ce petit territoire a été marqué par son caractère de marche frontière, à divers titres : - une zone tampon entre la langue d’oil et la langue d’oc : le franco-provençal.
- une zone tampon entre la langue d’oil et la langue d’oc : le franco-provençal. - les protestants et les catholiques s’y sont partagé leur frontière pendant les guerres de religion.
- les protestants et les catholiques s’y sont partagé leur frontière pendant les guerres de religion.  - Les nombreux chemins qui la traversaient constituaient un lien avec l’Ardèche et la Loire, à travers le massif du Pilat.
- Les nombreux chemins qui la traversaient constituaient un lien avec l’Ardèche et la Loire, à travers le massif du Pilat. - Seule l’appartenance ancienne à l’évêché de Vienne a réuni cette zone par delà les montagnes jusqu’à la vallée du Gier.
- Seule l’appartenance ancienne à l’évêché de Vienne a réuni cette zone par delà les montagnes jusqu’à la vallée du Gier. Le premier acte officiel attestant l’appartenance du Pilat rhodanien au Royaume de France date de 1349 : Humbert III, dauphin cédait à Philippe VI
Le premier acte officiel attestant l’appartenance du Pilat rhodanien au Royaume de France date de 1349 : Humbert III, dauphin cédait à Philippe VI (futur Charles V) l’Etat delphinal qui s’étendait du Lyonnais aux confins de la Provence.
(futur Charles V) l’Etat delphinal qui s’étendait du Lyonnais aux confins de la Provence. C’est dans ce cadre que se mêlent les nombreuses traces d’une vie religieuse intense, portée et entretenue par la population. , La conservation du
C’est dans ce cadre que se mêlent les nombreuses traces d’une vie religieuse intense, portée et entretenue par la population. , La conservation du patrimoine reste une préoccupation active et les nombreuses croix qui balisent les itinéraires sont autant de marques d’un attachement profond au
patrimoine reste une préoccupation active et les nombreuses croix qui balisent les itinéraires sont autant de marques d’un attachement profond au  patrimoine local.
patrimoine local. Il est fréquent de rencontrer des habitants qui en connaissent la grande et la petite histoire et qui en gardent jalousement la propriété tout en
Il est fréquent de rencontrer des habitants qui en connaissent la grande et la petite histoire et qui en gardent jalousement la propriété tout en partageant quelques secrets.
partageant quelques secrets. Randonner autour de ces croix nous fait découvrir une terre profondément marquée par les événements: les pestes du Moyen Age et les guerres de
Randonner autour de ces croix nous fait découvrir une terre profondément marquée par les événements: les pestes du Moyen Age et les guerres de religion ont gravé un attachement populaire mêlant dévotions, religion, craintes dans la vie collective.
religion ont gravé un attachement populaire mêlant dévotions, religion, craintes dans la vie collective. Les croix en sont une des expressions les plus modestes, mais constituent autant de signes de la recherche d’une protection divine, quelque peu
Les croix en sont une des expressions les plus modestes, mais constituent autant de signes de la recherche d’une protection divine, quelque peu  superstitieuse, où le salut se trouvait aussi bien dans l’Eglise que chez les guérisseurs.
superstitieuse, où le salut se trouvait aussi bien dans l’Eglise que chez les guérisseurs. Ceci était vrai déjà au temps des mégalithes… puis des druides. On en a retrouvé la trace sur des sites proches comme à Saint Sabin… Le rite
Ceci était vrai déjà au temps des mégalithes… puis des druides. On en a retrouvé la trace sur des sites proches comme à Saint Sabin… Le rite christianisé du ramassage de l'alchémille des Alpes - herbe de Saint Sabin – lors du pèlerinage de Pentecôte, assurerait la protection des troupeaux.
christianisé du ramassage de l'alchémille des Alpes - herbe de Saint Sabin – lors du pèlerinage de Pentecôte, assurerait la protection des troupeaux. La présence celtique a sans doute influencé le regroupement des habitants autour de lieux de culte placés sur des enrochements, comme à La Chaize
La présence celtique a sans doute influencé le regroupement des habitants autour de lieux de culte placés sur des enrochements, comme à La Chaize basse, par exemple.
Un peu d’histoire …
basse, par exemple.
Un peu d’histoire … Deux moments historiques ont particulièrement marqué l’histoire et l’imaginaire des habitants, au regard de notre objet d’investigation :
Deux moments historiques ont particulièrement marqué l’histoire et l’imaginaire des habitants, au regard de notre objet d’investigation : -
les pestes
-
les guerres de religion entre catholiques et protestants
-
les pestes
-
les guerres de religion entre catholiques et protestants 1/ Les pestes :
1347 : arrivée de la peste noire en Europe
1/ Les pestes :
1347 : arrivée de la peste noire en Europe  Localement :
1534 : une croix était érigée à Sagnemorte (un hameau de Roisey dont le nom traduit la présence d’eaux vives souterraines) pour protéger les
Localement :
1534 : une croix était érigée à Sagnemorte (un hameau de Roisey dont le nom traduit la présence d’eaux vives souterraines) pour protéger les habitants de la peste. Cette croix est actuellement démontée et ceux-ci ne souhaitent pas la remettre en place car « il y a eu assez de malheurs »
1564 : la peste à Lyon
1584 : peste à Malleval
habitants de la peste. Cette croix est actuellement démontée et ceux-ci ne souhaitent pas la remettre en place car « il y a eu assez de malheurs »
1564 : la peste à Lyon
1584 : peste à Malleval  1603 : érection généralisée des croix de fin de peste, souvent incrustées de bubons significatifs, de nombreux lieux portant le nom de “maladière”
1603 : érection généralisée des croix de fin de peste, souvent incrustées de bubons significatifs, de nombreux lieux portant le nom de “maladière”  Et pourtant d’autres épisodes se produiront, comme en attestent les registres locaux.
Et pourtant d’autres épisodes se produiront, comme en attestent les registres locaux. 1694 : nombreux décès à Malleval, les pestiférés sont accueillis dans un hôpital-refuge de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.
1694 : nombreux décès à Malleval, les pestiférés sont accueillis dans un hôpital-refuge de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. N’oublions pas que la population de la France est passée de 18 millions d’habitants à 10 millions d’habitants en un siècle de pestes…
N’oublions pas que la population de la France est passée de 18 millions d’habitants à 10 millions d’habitants en un siècle de pestes… 2/ Les guerres de religion :
2/ Les guerres de religion : Elles ont marqué le Pilat, région qui se trouvait à une frontière religieuse : au sud les huguenots, autour d’Annonay et au nord, les catholiques autour
Elles ont marqué le Pilat, région qui se trouvait à une frontière religieuse : au sud les huguenots, autour d’Annonay et au nord, les catholiques autour de Lyon et de Vienne. La réalité était plus complexe au regard des revirements des uns ou des autres :
de Lyon et de Vienne. La réalité était plus complexe au regard des revirements des uns ou des autres : 1561: Jean-de-Fay, catholique d’origine devenu protestant, fit régner la terreur, massacra et pilla avec ses troupes.
1561: Jean-de-Fay, catholique d’origine devenu protestant, fit régner la terreur, massacra et pilla avec ses troupes.  1562 : le baron des Adrets, François de Beaumont, se distingue par sa cruauté aussi bien avec les catholiques qu’avec les protestants : Feurs,
1562 : le baron des Adrets, François de Beaumont, se distingue par sa cruauté aussi bien avec les catholiques qu’avec les protestants : Feurs, Montbrison, Montrond. Il est nommé brièvement gouverneur du Dauphiné. Redevenu catholique il continue à semer la terreur jusqu’à sa mort
Montbrison, Montrond. Il est nommé brièvement gouverneur du Dauphiné. Redevenu catholique il continue à semer la terreur jusqu’à sa mort (1587).
(1587). 1573 : la nuit de massacre de la Saint-Barthélémy connaît un grand retentissement.
1574 : Christophe de-Saint-Chamond, seigneur de Vivarais pour mettre fin aux exactions du seigneur de Malleval, détruit maisons et château de
1573 : la nuit de massacre de la Saint-Barthélémy connaît un grand retentissement.
1574 : Christophe de-Saint-Chamond, seigneur de Vivarais pour mettre fin aux exactions du seigneur de Malleval, détruit maisons et château de Jean-de-Fay. Cet épisode marque le déclin de Malleval qui perdit son emprise sur les seigneurs des alentours.
Jean-de-Fay. Cet épisode marque le déclin de Malleval qui perdit son emprise sur les seigneurs des alentours. On parle encore de la bataille de Virecul qui s’est déroulée à Chuyer, à quelques kilomètres…
On parle encore de la bataille de Virecul qui s’est déroulée à Chuyer, à quelques kilomètres… Entre 1560 et 1562 de nombreuses croix ont été abattues par les « hérétiques »…puis reconstruites ultérieurement, souvent avec le concours de
Entre 1560 et 1562 de nombreuses croix ont été abattues par les « hérétiques »…puis reconstruites ultérieurement, souvent avec le concours de sculpteurs locaux, à l’art primitif.
Malleval détruite, l’église actuelle est reconstruite vers 1606 et probablement s’érige la croix, située vers l’entrée actuelle, datée de 1644.
sculpteurs locaux, à l’art primitif.
Malleval détruite, l’église actuelle est reconstruite vers 1606 et probablement s’érige la croix, située vers l’entrée actuelle, datée de 1644.  Depuis le 17 è siècle, nombre de croix ont encore été construites, et ont balisé les nombreux rites processionnels (notamment les rogations, soit les 3
Depuis le 17 è siècle, nombre de croix ont encore été construites, et ont balisé les nombreux rites processionnels (notamment les rogations, soit les 3 jours précédant l’Ascension), ceux qui scandaient l’agenda de l’année religieuse ou ceux de la vie tout court avec les reposoirs pour les dépouilles de
jours précédant l’Ascension), ceux qui scandaient l’agenda de l’année religieuse ou ceux de la vie tout court avec les reposoirs pour les dépouilles de  défunts, ou encore la recherche de la protection divine à travers les saints, tels que :
défunts, ou encore la recherche de la protection divine à travers les saints, tels que : -
Saint Pancrace, Saint Servais, Saint Mamert (évêque de Vienne au 5è siècle), qui sont les ‘’Saints de glace’’ qu’on implore toujours, du 11 au
-
Saint Pancrace, Saint Servais, Saint Mamert (évêque de Vienne au 5è siècle), qui sont les ‘’Saints de glace’’ qu’on implore toujours, du 11 au 13 Mai, pour se protéger des dégâts liés aux gelées printanières
13 Mai, pour se protéger des dégâts liés aux gelées printanières -
Saint Pancrace est aussi le protecteur du bétail
-
Les saints thaumaturges nombreux protègent de chaque maladie : Saint Roch pour la peste, Saint Antoine pour le « haut mal », Saint Eutrope
-
Saint Pancrace est aussi le protecteur du bétail
-
Les saints thaumaturges nombreux protègent de chaque maladie : Saint Roch pour la peste, Saint Antoine pour le « haut mal », Saint Eutrope pour les blessures…
pour les blessures… Nous n’avons pas toujours pu distinguer pour chaque croix sa consécration: balisage (croix de chemin ou croix de limite) et ce qui relevait de rituels
Nous n’avons pas toujours pu distinguer pour chaque croix sa consécration: balisage (croix de chemin ou croix de limite) et ce qui relevait de rituels plus religieux. Sans doute y avait-il, également un mélange des différentes finalités.
plus religieux. Sans doute y avait-il, également un mélange des différentes finalités. Rappelons qu’au concile de Clermont -1095 - le pape Urbain II avait proclamé que « quiconque, pour échapper à la poursuite de ses ennemis,
Rappelons qu’au concile de Clermont -1095 - le pape Urbain II avait proclamé que « quiconque, pour échapper à la poursuite de ses ennemis, demande refuge auprès d’une croix de chemin trouvera une protection aussi intangible que s’il avait gagné une église »
demande refuge auprès d’une croix de chemin trouvera une protection aussi intangible que s’il avait gagné une église » 
 Collonge et au Sud par les gorges de Malleval, deux petits ruisseaux, affluents de la rive droite du Rhône.
Collonge et au Sud par les gorges de Malleval, deux petits ruisseaux, affluents de la rive droite du Rhône. Le climat protégé de ce flanc Est du Pilat a permis à la population actuelle de se tourner vers l’agriculture fruitière. Les vergers de pommiers, de plus
Le climat protégé de ce flanc Est du Pilat a permis à la population actuelle de se tourner vers l’agriculture fruitière. Les vergers de pommiers, de plus en plus fréquemment couverts de protections plastiques, jouxtent très rapidement les sombres forêts de résineux que fragmentent ici et là les chirats,
en plus fréquemment couverts de protections plastiques, jouxtent très rapidement les sombres forêts de résineux que fragmentent ici et là les chirats, ces éboulements de cailloux caractéristiques de l’érosion du massif qui culmine à 1405 mètres d’altitude.
ces éboulements de cailloux caractéristiques de l’érosion du massif qui culmine à 1405 mètres d’altitude. L’habitat, volontiers dispersé, a pris appui sur des bourgs au riche passé historique : Pélussin, pays des sires de Virieu, mais aussi Maclas, au
L’habitat, volontiers dispersé, a pris appui sur des bourgs au riche passé historique : Pélussin, pays des sires de Virieu, mais aussi Maclas, au dynamisme économique récent, et, plus au bord du Rhône, les bourgades de Chavanay ou Saint-Pierre-de- Bœuf qui encadrent l’ancien bourg féodal
dynamisme économique récent, et, plus au bord du Rhône, les bourgades de Chavanay ou Saint-Pierre-de- Bœuf qui encadrent l’ancien bourg féodal de Malleval.
de Malleval. Historiquement, ce petit territoire a été marqué par son caractère de marche frontière, à divers titres :
Historiquement, ce petit territoire a été marqué par son caractère de marche frontière, à divers titres : - une zone tampon entre la langue d’oil et la langue d’oc : le franco-provençal.
- une zone tampon entre la langue d’oil et la langue d’oc : le franco-provençal. - les protestants et les catholiques s’y sont partagé leur frontière pendant les guerres de religion.
- les protestants et les catholiques s’y sont partagé leur frontière pendant les guerres de religion.  - Les nombreux chemins qui la traversaient constituaient un lien avec l’Ardèche et la Loire, à travers le massif du Pilat.
- Les nombreux chemins qui la traversaient constituaient un lien avec l’Ardèche et la Loire, à travers le massif du Pilat. - Seule l’appartenance ancienne à l’évêché de Vienne a réuni cette zone par delà les montagnes jusqu’à la vallée du Gier.
- Seule l’appartenance ancienne à l’évêché de Vienne a réuni cette zone par delà les montagnes jusqu’à la vallée du Gier. Le premier acte officiel attestant l’appartenance du Pilat rhodanien au Royaume de France date de 1349 : Humbert III, dauphin cédait à Philippe VI
Le premier acte officiel attestant l’appartenance du Pilat rhodanien au Royaume de France date de 1349 : Humbert III, dauphin cédait à Philippe VI (futur Charles V) l’Etat delphinal qui s’étendait du Lyonnais aux confins de la Provence.
(futur Charles V) l’Etat delphinal qui s’étendait du Lyonnais aux confins de la Provence. C’est dans ce cadre que se mêlent les nombreuses traces d’une vie religieuse intense, portée et entretenue par la population. , La conservation du
C’est dans ce cadre que se mêlent les nombreuses traces d’une vie religieuse intense, portée et entretenue par la population. , La conservation du patrimoine reste une préoccupation active et les nombreuses croix qui balisent les itinéraires sont autant de marques d’un attachement profond au
patrimoine reste une préoccupation active et les nombreuses croix qui balisent les itinéraires sont autant de marques d’un attachement profond au  patrimoine local.
patrimoine local. Il est fréquent de rencontrer des habitants qui en connaissent la grande et la petite histoire et qui en gardent jalousement la propriété tout en
Il est fréquent de rencontrer des habitants qui en connaissent la grande et la petite histoire et qui en gardent jalousement la propriété tout en partageant quelques secrets.
partageant quelques secrets. Randonner autour de ces croix nous fait découvrir une terre profondément marquée par les événements: les pestes du Moyen Age et les guerres de
Randonner autour de ces croix nous fait découvrir une terre profondément marquée par les événements: les pestes du Moyen Age et les guerres de religion ont gravé un attachement populaire mêlant dévotions, religion, craintes dans la vie collective.
religion ont gravé un attachement populaire mêlant dévotions, religion, craintes dans la vie collective. Les croix en sont une des expressions les plus modestes, mais constituent autant de signes de la recherche d’une protection divine, quelque peu
Les croix en sont une des expressions les plus modestes, mais constituent autant de signes de la recherche d’une protection divine, quelque peu  superstitieuse, où le salut se trouvait aussi bien dans l’Eglise que chez les guérisseurs.
superstitieuse, où le salut se trouvait aussi bien dans l’Eglise que chez les guérisseurs. Ceci était vrai déjà au temps des mégalithes… puis des druides. On en a retrouvé la trace sur des sites proches comme à Saint Sabin… Le rite
Ceci était vrai déjà au temps des mégalithes… puis des druides. On en a retrouvé la trace sur des sites proches comme à Saint Sabin… Le rite christianisé du ramassage de l'alchémille des Alpes - herbe de Saint Sabin – lors du pèlerinage de Pentecôte, assurerait la protection des troupeaux.
christianisé du ramassage de l'alchémille des Alpes - herbe de Saint Sabin – lors du pèlerinage de Pentecôte, assurerait la protection des troupeaux. La présence celtique a sans doute influencé le regroupement des habitants autour de lieux de culte placés sur des enrochements, comme à La Chaize
La présence celtique a sans doute influencé le regroupement des habitants autour de lieux de culte placés sur des enrochements, comme à La Chaize basse, par exemple.
Un peu d’histoire …
basse, par exemple.
Un peu d’histoire … Deux moments historiques ont particulièrement marqué l’histoire et l’imaginaire des habitants, au regard de notre objet d’investigation :
Deux moments historiques ont particulièrement marqué l’histoire et l’imaginaire des habitants, au regard de notre objet d’investigation : -
les pestes
-
les guerres de religion entre catholiques et protestants
-
les pestes
-
les guerres de religion entre catholiques et protestants 1/ Les pestes :
1347 : arrivée de la peste noire en Europe
1/ Les pestes :
1347 : arrivée de la peste noire en Europe  Localement :
1534 : une croix était érigée à Sagnemorte (un hameau de Roisey dont le nom traduit la présence d’eaux vives souterraines) pour protéger les
Localement :
1534 : une croix était érigée à Sagnemorte (un hameau de Roisey dont le nom traduit la présence d’eaux vives souterraines) pour protéger les habitants de la peste. Cette croix est actuellement démontée et ceux-ci ne souhaitent pas la remettre en place car « il y a eu assez de malheurs »
1564 : la peste à Lyon
1584 : peste à Malleval
habitants de la peste. Cette croix est actuellement démontée et ceux-ci ne souhaitent pas la remettre en place car « il y a eu assez de malheurs »
1564 : la peste à Lyon
1584 : peste à Malleval  1603 : érection généralisée des croix de fin de peste, souvent incrustées de bubons significatifs, de nombreux lieux portant le nom de “maladière”
1603 : érection généralisée des croix de fin de peste, souvent incrustées de bubons significatifs, de nombreux lieux portant le nom de “maladière”  Et pourtant d’autres épisodes se produiront, comme en attestent les registres locaux.
Et pourtant d’autres épisodes se produiront, comme en attestent les registres locaux. 1694 : nombreux décès à Malleval, les pestiférés sont accueillis dans un hôpital-refuge de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.
1694 : nombreux décès à Malleval, les pestiférés sont accueillis dans un hôpital-refuge de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. N’oublions pas que la population de la France est passée de 18 millions d’habitants à 10 millions d’habitants en un siècle de pestes…
N’oublions pas que la population de la France est passée de 18 millions d’habitants à 10 millions d’habitants en un siècle de pestes… 2/ Les guerres de religion :
2/ Les guerres de religion : Elles ont marqué le Pilat, région qui se trouvait à une frontière religieuse : au sud les huguenots, autour d’Annonay et au nord, les catholiques autour
Elles ont marqué le Pilat, région qui se trouvait à une frontière religieuse : au sud les huguenots, autour d’Annonay et au nord, les catholiques autour de Lyon et de Vienne. La réalité était plus complexe au regard des revirements des uns ou des autres :
de Lyon et de Vienne. La réalité était plus complexe au regard des revirements des uns ou des autres : 1561: Jean-de-Fay, catholique d’origine devenu protestant, fit régner la terreur, massacra et pilla avec ses troupes.
1561: Jean-de-Fay, catholique d’origine devenu protestant, fit régner la terreur, massacra et pilla avec ses troupes.  1562 : le baron des Adrets, François de Beaumont, se distingue par sa cruauté aussi bien avec les catholiques qu’avec les protestants : Feurs,
1562 : le baron des Adrets, François de Beaumont, se distingue par sa cruauté aussi bien avec les catholiques qu’avec les protestants : Feurs, Montbrison, Montrond. Il est nommé brièvement gouverneur du Dauphiné. Redevenu catholique il continue à semer la terreur jusqu’à sa mort
Montbrison, Montrond. Il est nommé brièvement gouverneur du Dauphiné. Redevenu catholique il continue à semer la terreur jusqu’à sa mort (1587).
(1587). 1573 : la nuit de massacre de la Saint-Barthélémy connaît un grand retentissement.
1574 : Christophe de-Saint-Chamond, seigneur de Vivarais pour mettre fin aux exactions du seigneur de Malleval, détruit maisons et château de
1573 : la nuit de massacre de la Saint-Barthélémy connaît un grand retentissement.
1574 : Christophe de-Saint-Chamond, seigneur de Vivarais pour mettre fin aux exactions du seigneur de Malleval, détruit maisons et château de Jean-de-Fay. Cet épisode marque le déclin de Malleval qui perdit son emprise sur les seigneurs des alentours.
Jean-de-Fay. Cet épisode marque le déclin de Malleval qui perdit son emprise sur les seigneurs des alentours. On parle encore de la bataille de Virecul qui s’est déroulée à Chuyer, à quelques kilomètres…
On parle encore de la bataille de Virecul qui s’est déroulée à Chuyer, à quelques kilomètres… Entre 1560 et 1562 de nombreuses croix ont été abattues par les « hérétiques »…puis reconstruites ultérieurement, souvent avec le concours de
Entre 1560 et 1562 de nombreuses croix ont été abattues par les « hérétiques »…puis reconstruites ultérieurement, souvent avec le concours de sculpteurs locaux, à l’art primitif.
Malleval détruite, l’église actuelle est reconstruite vers 1606 et probablement s’érige la croix, située vers l’entrée actuelle, datée de 1644.
sculpteurs locaux, à l’art primitif.
Malleval détruite, l’église actuelle est reconstruite vers 1606 et probablement s’érige la croix, située vers l’entrée actuelle, datée de 1644.  Depuis le 17 è siècle, nombre de croix ont encore été construites, et ont balisé les nombreux rites processionnels (notamment les rogations, soit les 3
Depuis le 17 è siècle, nombre de croix ont encore été construites, et ont balisé les nombreux rites processionnels (notamment les rogations, soit les 3 jours précédant l’Ascension), ceux qui scandaient l’agenda de l’année religieuse ou ceux de la vie tout court avec les reposoirs pour les dépouilles de
jours précédant l’Ascension), ceux qui scandaient l’agenda de l’année religieuse ou ceux de la vie tout court avec les reposoirs pour les dépouilles de  défunts, ou encore la recherche de la protection divine à travers les saints, tels que :
défunts, ou encore la recherche de la protection divine à travers les saints, tels que : -
Saint Pancrace, Saint Servais, Saint Mamert (évêque de Vienne au 5è siècle), qui sont les ‘’Saints de glace’’ qu’on implore toujours, du 11 au
-
Saint Pancrace, Saint Servais, Saint Mamert (évêque de Vienne au 5è siècle), qui sont les ‘’Saints de glace’’ qu’on implore toujours, du 11 au 13 Mai, pour se protéger des dégâts liés aux gelées printanières
13 Mai, pour se protéger des dégâts liés aux gelées printanières -
Saint Pancrace est aussi le protecteur du bétail
-
Les saints thaumaturges nombreux protègent de chaque maladie : Saint Roch pour la peste, Saint Antoine pour le « haut mal », Saint Eutrope
-
Saint Pancrace est aussi le protecteur du bétail
-
Les saints thaumaturges nombreux protègent de chaque maladie : Saint Roch pour la peste, Saint Antoine pour le « haut mal », Saint Eutrope pour les blessures…
pour les blessures… Nous n’avons pas toujours pu distinguer pour chaque croix sa consécration: balisage (croix de chemin ou croix de limite) et ce qui relevait de rituels
Nous n’avons pas toujours pu distinguer pour chaque croix sa consécration: balisage (croix de chemin ou croix de limite) et ce qui relevait de rituels plus religieux. Sans doute y avait-il, également un mélange des différentes finalités.
plus religieux. Sans doute y avait-il, également un mélange des différentes finalités. Rappelons qu’au concile de Clermont -1095 - le pape Urbain II avait proclamé que « quiconque, pour échapper à la poursuite de ses ennemis,
Rappelons qu’au concile de Clermont -1095 - le pape Urbain II avait proclamé que « quiconque, pour échapper à la poursuite de ses ennemis, demande refuge auprès d’une croix de chemin trouvera une protection aussi intangible que s’il avait gagné une église »
demande refuge auprès d’une croix de chemin trouvera une protection aussi intangible que s’il avait gagné une église »